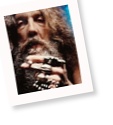L'Allemagne contre Napoléon (1813)
- Par Gimdolf_Fleurdelune
- 2174 vues
Les désastres de la Grande Armée en Russie et en Espagne furent le signal d'une explosion de haine contre Napoléon. Les Etats qu'il avait incorporés à l'empire l'abandonnèrent successivement. Mais c'est en Allemagne que le mouvement de résistance prit les proportions les plus inquiétantes.
La Révolution française avait, par des remaniements territoriaux, diminué le nombre des Etats allemands et éveillé l'idée d'une unité nationale, qui parut, à la suite de l'invasion napoléonienne, s'incarner dans la Prusse sous l'influence de ses ministres et de ses intellectuels.

Ainsi, le baron Karl vom Stein abolit le servage, restreignit les privilèges de la noblesse, édicta l'égalité devant la loi, simplifia le régime des corporations, améliora l'organisation administrative. Napoléon exigea son renvoi, mais son successeur, Hardenberg, continua ses réformes, d'ailleurs inspirées de l'influence française. En même temps, Schiller, Fichte et Schleiermacher imprimaient un vigoureux élan au patriotisme, entraînant par leur exemple la jeunesse des Universités.
En 1808 fut fondée, à Koenigsberg (auj. Kaliningrad), une société ayant pour objet le relèvement de la conscience allemande par l'éducation et la propagande nationales : le Tugenbund (Association de la Vertu), laquelle comptait parmi ses membres des étudiants et des professeurs d'université ; il était dirigé par un comité supérieur de six membres, qui donnait l'impulsion aux comités provinciaux et ceux-ci aux comités locaux. Napoléon obligea le roi de Prusse à dissoudre l'association (31 décembre 1809), mais elle continua son oeuvre en secret, encouragée par des hommes comme Niebuhr et Guillaume de Humboldt, et elle joua un rôle des plus actifs dans la guerre d'indépendance de 1813.
La Prusse, frémissante, releva la tête en apprenant la destruction de la Grande Armée, en voyant Napoléon passer à Dresde presque en fugitif. Après la retraite de Russie, les alliés, sur qui continuait d'agir le prestige napoléonien, hésitaient encore à passer la Vistule, d'autant que l'Autriche gardait une attitude expectante. Ce qui les décida, ce fut l'élan de la Prusse, où Scharnhorst avait préparé une année nouvelle en faisant passer successivement sous les drapeaux toutes les recrues.
Le roi Frédéric-Guillaume III, timide et indécis, désavoua d'abord York, qui avait conclu avec les Russes la convention de Poserehun ; mais, entraîné par la province de Prusse-Orientale, dont les Etats votaient la levée de la Landwehr et de la Landsturm, il se décida à se rendre à Breslau, en dehors de l'occupation française, au milieu des membres les plus fougueux du parti national.

Il signa avec le tsar le traité d'alliance de Kalish (28 février 1813), suivi bientôt de son fameux "Appel au peuple" (17 mars) :
"Brandebourgeois, Prussiens, Silésiens, Poméraniens, Lithuaniens ! Vous savez ce que vous avez souffert depuis sept ans ! Vous savez quel sort vous attend si nous ne terminons pas avec honneur la lutte qui commence..."
Les volontaires affluèrent de tous côtés dans l'armée prussienne, qui compta bientôt 150 000 hommes, et alors commença la "guerre des nations", la revanche des humiliations subies depuis Iéna.
Pendant ce temps, la Russie se réconciliait avec la Suède et l'Angleterre, formant bientôt l'ébauche de la grande ligue européenne de 1813. Seul, le Danemark, se souvenant de l'odieux bombardement de Copenhague et menacé par la Suède, refusa d'entrer dans la coalition.
La Grande Armée de 1813.
La France était alors épuisée. Elle combattait depuis plus de vingt ans. Et pourtant Napoléon trouva encore les hommes et les cadres dont il avait besoin. Les 140 000 conscrits de la classe 1813 ayant été déjà incorporés par anticipation, il appela rétrospectivement 100 000 hommes qu'avaient épargnés les levées antérieures et il anticipa sur la levée de 1814. Les jeunes gens de la noblesse et de la bourgeoisie furent également incorporés, même ceux qui s'étaient précédemment rachetés, et durent s'équiper et monter à leurs frais pour former les quatre régiments de "gardes d'honneur" de l'empereur.
Mais le haut commandement laissait à désirer. Berthier était fatigué, Gouvion frondeur, Davout traité en suspect, Vandamme insupportable par son caractère ; les nouveaux chefs de corps, comme Bertrand et Lauriston, n'avaient jamais commandé d'infanterie. Napoléon lui-même semblait moins ardent.
Au final, ce furent 530 000 hommes qui furent peu à peu envoyés vers l'Allemagne. Tous jeunes, ils se conduisirent héroïquement, mais n'eurent pas assez d'endurance ni de résistance morale.
- Napoléon partit de Mayence avec 135 000 hommes le 26 avril et le 2 mai, il écrasa Blücher, York et Wittgenstein à Lützen, les forçant à battre en retraite, et, chassant devant lui les forces autro-prussiennes, les délogea par la victoire de Bautzen (20-21 mai) de leurs positions derrière la Sprée. Bessières, duc d'Istrie, fut tué la veille de Lützen et Duroc, duc de Frioul, tomba sur le champ de Bautzen.
Armistice de Pleswitz. Conférences de Prague.
L'Autriche, qui venait de rentrer dans la coalition, offrit sa médiation après la signature de l'armistice de Pleswitz qui suspendit les opérations. Mais Metternich, son chancelier, ne désirait pas sincèrement la paix, bien qu'il ait affirmé le contraire dans ses Mémoires. Son intervention visait seulement à donner aux alliés le temps de se préparer et de s'entendre entre eux. Son habileté fut telle que tout le monde, sauf Napoléon, crut à ses propositions.
Le congrès de Prague ne fut qu'un trompe-l’œil. Jamais les alliés n'eurent l'intention de traiter, en laissant à la France ses limites naturelles ; ils négocièrent tout en marchant. La Russie, soucieuse de rassurer l'Angleterre, expliqua à son ministre des Affaires étrangères que l'armistice avait pour but de précipiter l'accession du cabinet de Vienne à la coalition.
Le 7 août, l'empereur d'Autriche fit demander à Napoléon de consentir au partage du Grand-Duché de Varsovie entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, à l'indépendance des villes hanséatiques, à la cession des provinces illyriennes, à l'indépendance de la Hollande, de l'Espagne, à la reconstitution territoriale de la Prusse, à la renonciation de l'empereur au protectorat de la Confédération du Rhin et au titre de médiateur de la Confédération helvétique ; sinon les troupes autrichiennes se joindraient aux troupes russo-prussiennes.
Napoléon répondit à Metternich :
"Qu'est-ce qu'on veut de moi ? Que je me déshonore ? Jamais ! ... Vos souverains, nés sur le trône, peuvent se laisser battre vingt fois et rentrer ensuite dans leurs capitales. Moi je ne le suis pas, parce que je ne suis qu'un soldat parvenu."
Le 10 août, à minuit, Metternich déclara les conférences dissoutes et l'Autriche en état de guerre.
La campagne d'automne pouvait commencer.
L'Angleterre prend à sa solde plus de la moitié de l'Europe. Wellington, vainqueur à Vittoria, vint s'établir sur la Bidassoa. Bernadotte qui, depuis son avènement au trône de Suède, semble avoir tout oublié de son ancienne nationalité, s'allia dès 1812 avec le tsar ; il commandait une des armées alliées et se berçait même du fol espoir de remplacer Napoléon aux Tuileries.
En trois marches forcées, Napoléon arrivait à Dresde le 26 août, alors que les alliés s'étaient déjà emparés des faubourgs. Il brisa une attaque générale et, pendant la nuit, reçut des renforts qui portaient son armée à 110 000 hommes.
Le 27 au matin, prenant l'offensive, il attaqua les deux ailes de l'armée ennemie, pendant que l'artillerie occupait le centre pour l'empêcher de se porter au secours des extrémités. Tandis que Ney et Mortier refoulent l'aile droite et que Gouvion Saint-Cyr se tient sur la défensive, Victor attaque l'aile gauche, que Murât, avec 20 000 cavaliers de Pajol et de Latour-Maubourg, prend par derrière et rejette dans le ravin de Plauen ; 13 000 hommes, 3 généraux, 15 drapeaux et 26 pièces de canon sont pris, et la nuit même, à la nouvelle que Vandamme, ayant passé l'Elbe à Koenigstein, est en marche sur Toeplitz et menace la route de Bohême, les alliés commencèrent la retraite.
Battus malgré leur supériorité numérique, les alliés choisirent dorénavant d'attaquer en détail chacun des lieutenants de Napoléon. Ainsi, le 23 août, Bernadotte força Oudinot à reculer à Gross-Beeren ; MacDonald fut défait à Katzbach par Blücher et perdit 30 000 hommes (27 août) ; Vandamme capitula à Kulm, après avoir perdu 6000 morts et 7000 prisonniers (20-30 août) ; Ney, à Dennewilz, laissa 15 000 hommes et 35 canons (6 septembre).
La bataille de Leipzig (18-19 octobre 1813).

Napoléon rassembla ses forces pour un choc suprême autour de Leipzig. Les coalisés, deux fois plus nombreux, vinrent y engager une lutte de trois jours (16, 17, 18 octobre) : la défection des Saxons sur le champ de bataille achève la victoire de la coalition. Cette bataille des nations (Volkerschlacht) avait mis aux prises plus de 500 000 hommes ; les coalisés avaient 8 000 hommes hors de combat ; les Français perdirent 50 000 hommes, dont 3 000 prisonniers.
Napoléon se replia sur la France, par Hanau, où il culbuta au passage les Bavarois, qui voulaient lui couper la retraite (30 octobre), et arriva à Mayence. Il eut le tort de laisser dans les principales places fortes de l'Allemagne 170 000 hommes qu'il réservait pour attaquer les alliés à revers, le jour où il reprendrait l'offensive. La plupart des garnisons françaises durent capituler : Saint-Cyr et Mouton à Dresde (15 novembre), Rapp à Dantzig (27 novembre), Davout résista cependant à Hambourg jusque après l'abdication de l'empereur.
Propositions de Francfort.
Au nom des alliés, Metternich, profitant du passage à Francfort d'un diplomate français, Auguste de Saint-Aignan, ambassadeur de France à Weimar, fit offrir à Napoléon de reconnaître à la France la possession des limites naturelles (9 novembre 1813). Saint-Aignan crut aux insinuations de Metternich et des alliés. Il y fit croire les politiques ; Talleyrand, Vitrolles, Dalberg, Marchand, Roux-Laborde et autres intrigants secondèrent si bien le chancelier autrichien que Paris ajouta foi aux ouvertures de Francfort, qui n'étaient qu'un leurre. D'ailleurs, il était hors de question pour l'Angleterre que la France gardât la Belgique et elle retarda par tous les moyens la réunion du Congrès.
Pendant ce temps, en Hollande, c'est l'insurrection. Le 30 novembre 1813, le prince d'Orange, fils de Guillaume, débarque à Scheveningue et est proclamé roi des Pays-Bas.
En Italie, Eugène de Beauharnais était resté fidèle à l'empereur. Le 17 août, alors qu'il attendait sur la Save des renforts napolitains, qui ne vinrent jamais, il fut attaqué par le général Hiller ; vainqueur à Laybach, il se maintint deux mois en Illyrie, mais la défection des Bavarois le contraignit à se retirer sur l'Isonzo, puis sur la Piave ; vainqueur encore à Bassano, le 1er novembre, il lui fallut cependant reculer jusque sur l'Adige pour assurer ses communications ; enfin, la bataille de Caldiero arrêta momentanément l'invasion.
Les coalisés essayèrent vainement de corrompre Eugène par l'intermédiaire de son beau-père, le roi de Bavière, lui proposant de payer sa défection au prix d'un trône en Italie, mais Eugène resta inébranlable et avertit l'empereur.
Quant à Murât, entraîné par son ambition et poussé par Caroline, il continuait la pente qui devait le conduire à la trahison. Joseph avait dû quitter l'Espagne, définitivement perdue malgré tout le sang versé, et le Danemark, isolé, faisait sa paix avec la Russie et l'Angleterre.
Napoléon restait seul avec 60 000 hommes, en face de la coalition la plus formidable qui eût jamais menacé l'existence d'une nation à laquelle il allait opposer toutes les ressources de son génie.